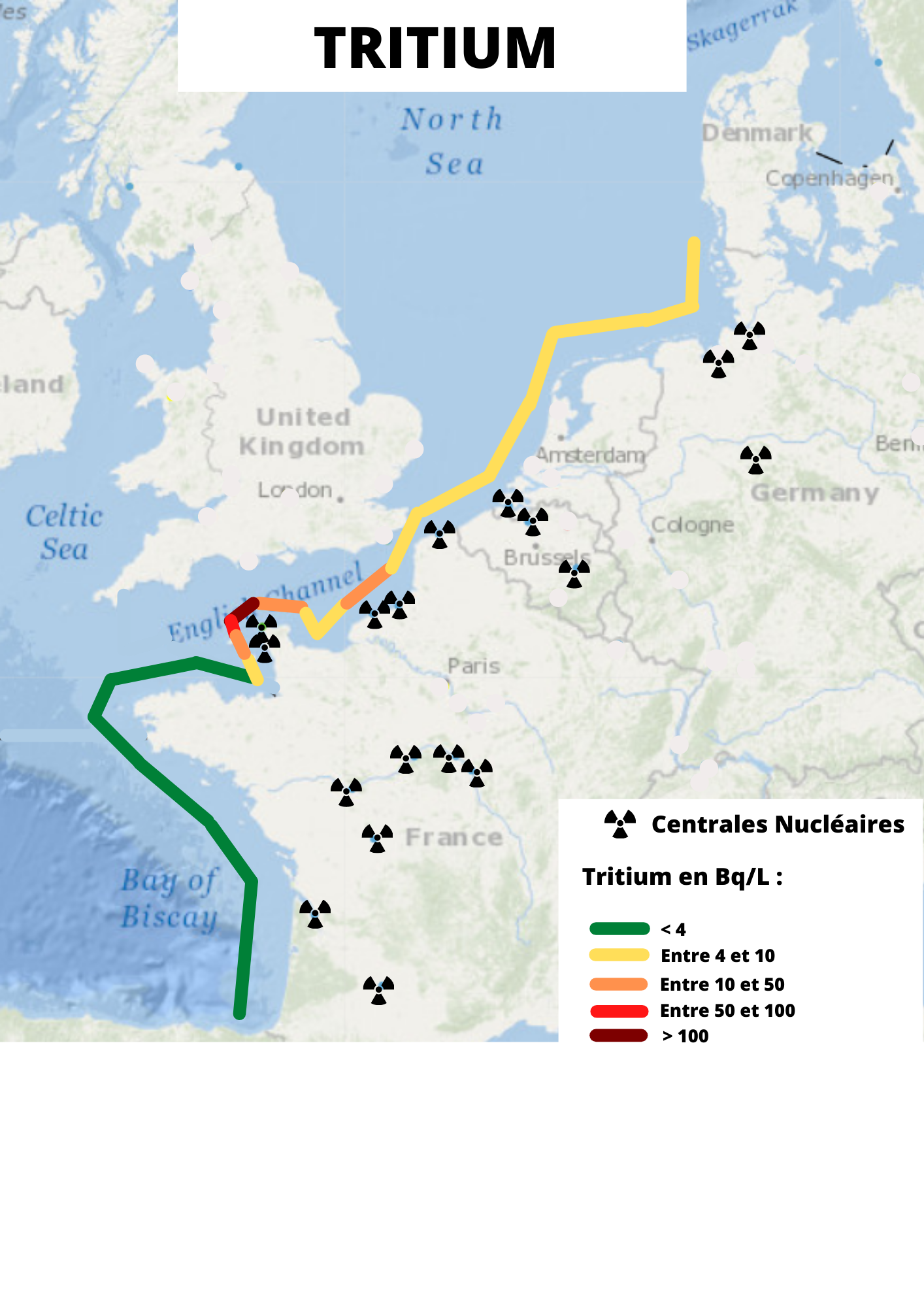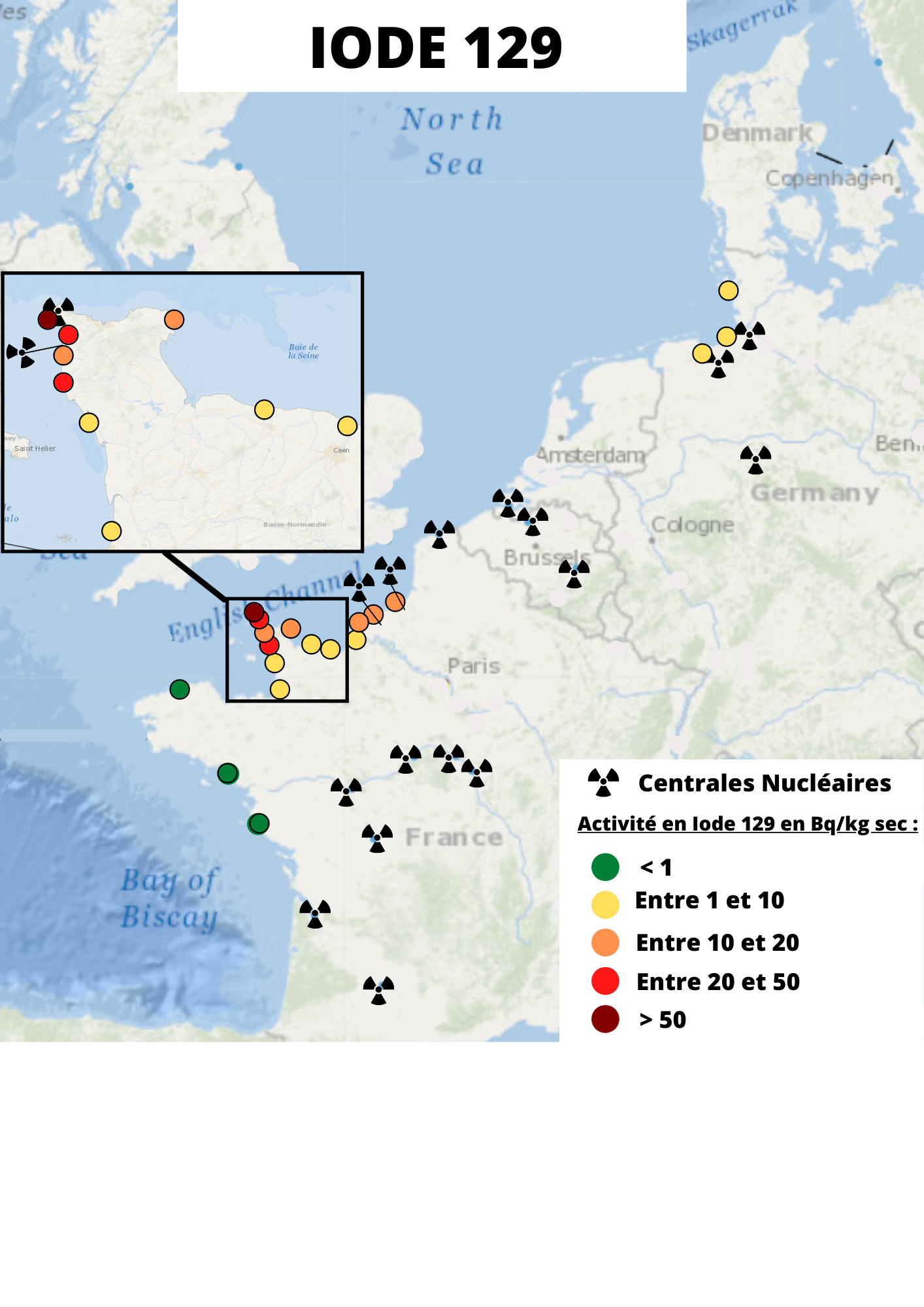Le 8 février 2023, le gouvernement avait annoncé vouloir démanteler l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l’expert officiel. L’expertise devait passer sous la tutelle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et la recherche retourner au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), comme c’était le cas au siècle dernier. Ce projet de réforme imposé sans justification ni concertation a provoqué une levée de boucliers de tous les côtés (lire la réaction de l’ACRO, qui avait publié la lettre de mission adressée à l’ASN, l’IRSN et le CEA), une grève massive du personnel de l’IRSN et un vote défavorable du parlement, le 15 mars 2023.
Mais le gouvernement n’a pas lâché l’affaire : le Conseil de Politique Nucléaire (CPN) du 19 juillet 2023 « a décidé d’un renforcement significatif de la gouvernance du nucléaire ». Aucun argument ni justification ne sont apportés. Il est juste fait référence à un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) « qui recommande de créer une grande autorité indépendante de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dont les moyens financiers et humains seraient renforcés. Cette nouvelle autorité permettra d’adapter la sûreté nucléaire face aux 3 défis de la relance nucléaire que sont (i) la prolongation du parc existant, (ii) la construction de nouveaux EPR et (iii) le développement de petits réacteurs modulaires innovants. Le CPN a confirmé la volonté du Gouvernement d’avancer en ce sens en veillant à ce que l’ensemble des missions de l’ASN et l’IRSN soient préservées et leurs moyens humains renforcés. »
Quels sont les arguments avancés par le rapport de l’OPECST en faveur de cette réforme ?
Le rapport commence par vanter le système actuel de contrôle qui jouit d’une « réputation élevée » dans les arènes internationales. Il souligne aussi l’excellence de la recherche menée par l’IRSN, qui nourrit l’expertise et lui assure « les moyens d’investigation les plus performants ». Le système dual actuel, avec l’expertise séparée de l’autorité – ce qui est remis en cause par le gouvernement – n’est pas non plus critiqué par le rapport de l’OPECST qui note que « l’existence d’un écart entre les expertises et la décision n’est pas par elle-même problématique, tant que les premières ne forcent pas la seconde ».
Alors, pourquoi vouloir changer le système ? Comme le souligne aussi le CPN, l’ASN et l’IRSN vont faire face à un accroissement des travaux liés au parc actuel, vieillissant, et au nouveau parc à construire. Et le gouvernement ne semble pas prêt à mettre les moyens nécessaires pour l’expertise et le contrôle. Alors, sous couvert de « fluidifier » les procédures, il espère faire des économies d’échelle en fusionnant l’ASN et l’IRSN. A ce propos, le rapport précise : « bien que l’organisation actuelle ait permis de gérer de façon satisfaisante les enjeux de sûreté nucléaire et de radioprotection depuis 2006, dans un contexte de calme relatif dans le domaine de l’industrie nucléaire, elle pourrait être moins adaptée à ce nouveau contexte. »
Jamais, le rapport de l’OPECST n’explique en quoi le nouveau système, qu’il va jusqu’à baptiser en Autorité indépendante en sûreté nucléaire et radioprotection, ou AISNR, serait plus performant ou mieux adapté. Au contraire, il souligne que des personnes auditionnées « ont attiré l’attention sur les tensions, frictions et inquiétudes inéluctables que fait naître toute perspective de changement institutionnel », sans plus de précisions, ce qui est bien dommage. Et le rapport de souligner, en langage technocratique, que les bouleversements envisagés vont engendrer des difficultés nouvelles : « Puisqu’est projetée une évolution structurelle, il faut s’attendre à ce que son appropriation par les acteurs fasse l’objet d’une courbe d’apprentissage : le risque n’est pas exclu que l’organisation ait d’abord tendance à piétiner, voire à légèrement régresser, avant de s’engager sur la voie d’un progrès global. » Aucune durée de la « courbe d’apprentissage » n’est donnée.
Et sans la moindre analyse de risque, la conclusion est de foncer vers le nouveau système car « cette période transitoire, par nature délicate, ne saurait donc être concomitante avec la phase opérationnelle des nouveaux programmes attendus, ce qui ouvre, pour une éventuelle réorganisation, une fenêtre d’opportunité relativement étroite, sans doute d’ici fin 2024. » Cela ne laisse pas beaucoup de temps à la ministre de la transition énergétique, missionnée par le CPN pour « engager les concertations avec les parties prenantes et les parlementaires en vue de préparer un projet de loi d’ici l’automne ». La sûreté nucléaire et la radioprotection sont des biens communs. Une réforme d’une telle ampleur nécessite un projet clair qui permet de comprendre les bénéfices obtenus et de mener des consultations, forcément longues et difficiles. Avec un projet de loi à l’automne, il faut donc s’attendre à un passage en force.
Pour ce qui est des activités commerciales de l’IRSN, qui n’ont pas leur place au sein d’une autorité administrative indépendante, elles devraient être externalisées. Quant à l’expertise pour le nucléaire de défense de l’IRSN, elles pourraient être transférée au ministère de la défense qui sera juge et partie. La sûreté n’en sortira pas grandie. Mais c’est ce que suggère l’amiral Guillaume, consulté. Alors, pas besoin de poser la question à d’autres…
Quels sont les risques du nouveau système aux contours bien flous ?
Suite à la première tentative de fusion entre l’ASN et l’IRSN, seuls les salariés de l’IRSN se sont mis en grève car il ne s’agit pas d’une fusion entre deux entités mais de la mise sous tutelle de l’expert. Le fait que le Directeur général de l’IRSN n’ait pas été consulté en amont, ni même informé, n’est pas rassurant. La première version du projet prévoyait, en plus, un complet démantèlement de l’Institut avec le transfert des activités de recherche au CEA. Le rapport parlementaire mentionne le maintien, « en première approche », de la recherche au sein de l’AISNR.
A propos de la recherche, le rapport ne parle que d’excellence à maintenir et renforcer. Rien sur l’ouverture à la société, le lien avec l’expertise, la gouvernance, la publication des résultats…
Quant à l’expertise, pourra-t-elle faire l’objet de pression en interne d’une seule entité ? C’est l’une des craintes le plus souvent exprimées. En particulier, l’IRSN publie ses avis indépendamment de la décision de l’ASN, souvent en amont. Les rapporteurs soulignent que « les expertises devront continuer d’être publiées à destination du grand public : au lieu d’être des expertises de l’IRSN, ces études seront simplement celles des services instructeurs d’une nouvelle autorité. À l’avenir, même si les rapporteurs ne sauraient se prononcer sur un calendrier idéal de publication, il leur semble, dans un souci d’apaisement, que les expertises et recommandations doivent être diffusées de manière concomitante, au moment où l’autorité indépendante rend sa décision. » Que signifie « dans un souci d’apaisement » ? Si cela n’avait pas été un sujet de controverse, la publication des expertises n’aurait plus été garantie ?
De fait, le rapport ne contient pas un mot sur la gouvernance de la nouvelle entité. L’IRSN est dotée d’un conseil d’administration, d’un conseil scientifique et d’un comité d’orientation des recherches. Que vont-ils devenir ? La relation avec la société civile, va au-delà de la simple transparence, qui devra être maintenue à un même « niveau élevé ».
Cela en fait des détails à régler pour un projet de loi à l’automne ! Que veut le gouvernement ? Le rapport de l’OPECST semble nostalgique d’un âge d’or qui se concrétisa « par la construction, pour l’essentiel sur quinze ans, de 1971 à 1986, d’un parc de 58 réacteurs nucléaires. » Et d’ajouter que « l’une des explications majeures de cette réussite porte sur la souplesse du système de contrôle de la sûreté nucléaire et le caractère pragmatique de la démarche française dans ce domaine. » Que signifie cette « souplesse » ? Du laxisme, comme en Chine, où deux EPR ont été construits plus rapidement qu’en Europe ?
Le passage sur le projet de piscine centralisée est symptomatique de ce pourrait être la « souplesse » espérée. EDF n’a toujours pas transmis de dossier de demande d’autorisation de création alors que l’ASN lui a demandé de le faire avant décembre 2020. Ce retard n’est pas mentionné dans le rapport de l’OPECST qui reporte toute la charge sur le contrôle : « Ce dossier devra être instruit dans des délais très brefs, le risque d’une saturation de l’entreposage actuel, anticipée à l’horizon 2030, ayant été accentué par les difficultés de fabrication de combustible MOX survenus ces dernières années. » Les rapporteurs auraient plutôt dû s’interroger sur un renforcement des pouvoirs du contrôleur afin qu’EDF respecte ses décisions…
Il y a eu deux catastrophes nucléaires majeures depuis cet âge d’or, fantasmé, et il n’est pas possible de revenir en arrière. Rappelons que le système de contrôle actuel, avec l’expertise séparée de l’autorité, a été préconisé en 1998 par Jean-Yves Le Déaut, député de la Meurthe-et-Moselle, suite à une saisine de Lionel Jospin alors premier ministre (et non Michel Rocard, comme écrit par erreur dans le rapport de l’OPECST). Il s’agissait alors de répondre à « une crédibilité écornée de l’ensemble du système », notamment, à cause du « nuage de Tchernobyl qui vient le premier fragiliser la confiance que les citoyens pouvaient avoir dans le système » de l’époque. Dans le rapport de l’OPECST, cela se traduit par « en France, l’idée de la nécessité d’un contrôle plus indépendant fait son chemin » et c’est tout !
Sans comprendre les erreurs du passé, il n’est pas possible de construire un système de contrôle robuste.
Conclusions
Insistons sur le fait que la sûreté nucléaire et la radioprotection sont des biens communs indispensables à la protection des populations qui doivent donc être consultées. Le passage en force du gouvernement est donc inadmissible. Alors que trois anciens présidents de l’OPECST, de trois familles politiques différentes, avaient alerté, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, sur ce qu’ils considèrent être une « une dérive technocratique dangereuse », le rapport de ce même Office, rédigé à la va-vite pour relancer le projet gouvernemental après son rejet par le parlement ne fait aucune analyse des faiblesses du système actuel ni des bénéfices et des risques du nouveau système. Ce rapport est affligeant et ne grandit pas l’OPECST.
L’ACRO est attachée au système dual, avec l’expertise clairement séparée de l’autorité, qui a fait ses preuves, mais appelle aussi à une plus grande liberté académique pour les chercheurs qui, à l’IRSN, ne sont pas libres de publier ou de parler aux médias. Et, sur certains domaines non soumis au secret, il y a nécessité de voir émerger d’autres acteurs, aussi bien en recherche qu’en expertise. Rien ne permet de penser que la réforme gouvernementale, imposée par le haut, sans concertation avec toutes parties prenantes, apporte le moindre progrès. Au contraire, elle va commencer par déstabiliser tout le système actuel, avec un risque de dégradation pérenne.